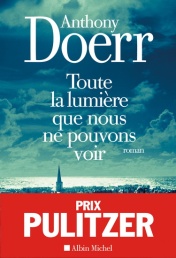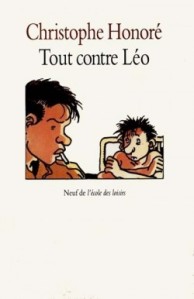TOUTE LA LUMIÈRE QUE NOUS NE POUVONS VOIR, Anthony Doerr (2015)
Il est toujours honteux d’avoir à reconnaître que l’on peut parfois se montrer influençable. La couverture de Transfuge du mois de Juin-Juillet intitulée « Antony Doerr, un Pulitzer mérité » a suffi à éveiller en moi une curiosité double : ce magazine de qualité a apprécié le roman et l’auteur a obtenu un prix prestigieux – argument limité, mais lorsque l’on sait que le Pulitzer est également tombé dans l’épuisette d’Harper Lee, John Steinbeck ou plus récemment Philip Roth et Cormac McCarthy, l’on rougit beaucoup moins –. Première rencontre littéraire donc avec Anthony Doerr, rendez-vous qui s’est fait agréable et intense bien qu’en refermant cette œuvre une certaine perplexité m’eut envahie ; car l’auteur américain offre un livre dense, documenté et palpitant en forme de roman initiatique sur fond de Seconde Guerre mondiale d’où s’échappe un aspect naïf – évoqué dans les pages de Transfuge – qui m’a personnellement légèrement dérangée et irritée…
Toute la lumière que nous ne pouvons voir est comme un long chemin bordé de destins croisés avec, en personnages principaux, Marie-Laure, jeune aveugle française réfugiée à Saint-Malo chez son grand-oncle avec son père et, du côté de l’Allemagne, Werner, orphelin surdoué qui manie à la perfection l’électronique et les mathématiques, jeune prodige aux doigts d’or spécialisé dans les transmissions radio qui ne tardera pas à éveiller la curiosité et l’intérêt de dignitaires militaires assoiffés de sang. Chacun vit la guerre à travers le prisme de sa jeunesse et si le fond miséreux des deux camps se rejoint, la forme elle devrait différer, avec les bons d’un côté et les méchants de l’autre. Sauf que chez Doerr nous n’en sommes plus vraiment là, l’auteur s’abstenant de tout jugement ou dichotomie hasardeuse puisqu’ici l’on parle de jeunes âmes qui, quel que soit le camp, restent des victimes de la barbarie la plus infâme. Toute la lumière que nous ne pouvons voir c’est aussi l’histoire d’un diamant maudit qu’un expert nazi rêve de posséder et le destin de gamins allemands persécutés dans des écoles d’élite où le dressage sauvage rend fou et ce dans l’unique but d’envoyer au front de futures bêtes sanguinaires ; une grande fresque historico-fictionnelle qui s’étale sur plus de 70 ans où l’on s’attache au parcours d’enfants qui grandissent au milieu des bombes et des privations, confrontés à la folie des Hommes et dont les vies finiront par se rejoindre et se croiser. Toute la lumière que nous ne pouvons voir c’est aussi la résistance et les petites collaborations – l’écrivain restant aimable sur le sujet –, la délation, les internements, mais aussi la solidarité d’un peuple ostracisé, la Libération, l’existence bouleversée et tyrannisée où la brutalité et le malheur font écho à la tendresse et aux fugaces instants de félicité.
Chez Anthony Doerr l’écriture est belle, adroite et réfléchie, le roman emmené par de courts chapitres (de deux à quatre pages maximum) où l’on passe d’une année à l’autre et d’une vie à la suivante, ce qui confère à l’écrit dynamisme et acuité, bien que ce parti pris puisse parfois donner le tournis. Les idées fusent, les – habiles et maîtrisées – descriptions s’enchaînent ainsi que pléthore de moments de grâce plus ou moins poétiques et un tantinet trop candides à mon goût. Un écrit que je qualifierais par conséquent de très « américain » car, si j’étais un brin paranoïaque, je me demanderais s’il n’a pas été rédigé dans le but manifeste d’en transformer très vite les mots en pellicule de film ; tout y est pour bientôt brandir bien haut un long-métrage estampillé « hollywoodien » : la guerre, les joies, les peines, l’horreur, les bons sentiments, les destins extraordinaires, les rencontres fortuites (à la limite du vraisemblable), les aventures presque « tintinesques » et le suspense. L’un de ces films qui font à la fois frissonner d’horreur tout en tirant la petite larme et où le romantisme le dispute au drame, se rapprochant beaucoup plus de Pearl Harbor que d’Apocalypse Now ou Full Metal Jacket.
Ne soyons pas mauvaise langue et prenons ce roman pour ce qu’il est, une œuvre travaillée, captivante et portée par une jolie plume d’où ressort un véritable investissement de la part de l’écrivain, même si l’ensemble peut sembler de temps à autre grandiloquent et s’égare entre un réalisme prospère et une naïveté déconcertante. Il n’est pas dit qu’un auteur français aurait traité le sujet de la même manière, ce qui en fait justement une curiosité à découvrir…